
| Date france : |
2016.08.18 |
| Editeur : |
Les mains lâchées
2016
2½ h
D'après votre vitesse de lecture (15 000 mots à l'heure), il devrait vous falloir environ 2½ h pour lire ce livre.
Temps restant en fonction de l'avancement :
| 14 % | 57 % |
| 2 h | 1 h |
Aux Philippines, une jeune journaliste française tente de continuer à vivre dans le chaos du typhon Yolanda qui a emporté son compagnon. Un premier roman d’une justesse tragique.
Madel, journaliste française aux Philippines, est venue passer quelques jours à Tacloban, la ville natale de son petit ami, Jan. Mais un typhon de catégorie 5, Yolanda, le plus fort de l’histoire de l’humanité, s’invite sur cette île de Leyte. En soulevant une vague de six mètres, il dévaste tout sur son passage, emporte plus de 7000 personnes. Parmi elles, Jan. Madel échappe de peu à la noyade, sans parvenir à sauver l’enfant qu’il lui avait confié.
Au milieu du chaos, au prix d’une difficile anesthésie de ses sentiments, Madel doit assumer son rôle de journaliste. Elle rencontre d’autres survivants : Baba, la grand-mère du village, Jirug le Valeureux, un gamin de dix ans, Jack, le pompier devenu croque-morts, David le médecin...
Dans ce monde ravagé, où ses confrères journalistes se transforment en vautours, Madel va tenter de trouver sa place et de recueillir la parole survivante, pour conjurer la mort qui a peut-être emporté Jan, pour avoir une raison de continuer à vivre. Mais un typhon de cette violence ne laisse jamais en paix ceux qu’il a épargnés.
Madel, journaliste française aux Philippines, est venue passer quelques jours à Tacloban, la ville natale de son petit ami, Jan. Mais un typhon de catégorie 5, Yolanda, le plus fort de l’histoire de l’humanité, s’invite sur cette île de Leyte. En soulevant une vague de six mètres, il dévaste tout sur son passage, emporte plus de 7000 personnes. Parmi elles, Jan. Madel échappe de peu à la noyade, sans parvenir à sauver l’enfant qu’il lui avait confié.
Au milieu du chaos, au prix d’une difficile anesthésie de ses sentiments, Madel doit assumer son rôle de journaliste. Elle rencontre d’autres survivants : Baba, la grand-mère du village, Jirug le Valeureux, un gamin de dix ans, Jack, le pompier devenu croque-morts, David le médecin...
Dans ce monde ravagé, où ses confrères journalistes se transforment en vautours, Madel va tenter de trouver sa place et de recueillir la parole survivante, pour conjurer la mort qui a peut-être emporté Jan, pour avoir une raison de continuer à vivre. Mais un typhon de cette violence ne laisse jamais en paix ceux qu’il a épargnés.
Si vous avez aimé ce livre, ceux-ci peuvent vous plaire : Ces livres vous sont proposés car les lecteurs de NousLisons.fr qui ont aimé Les mains lâchées les ont également appréciés.
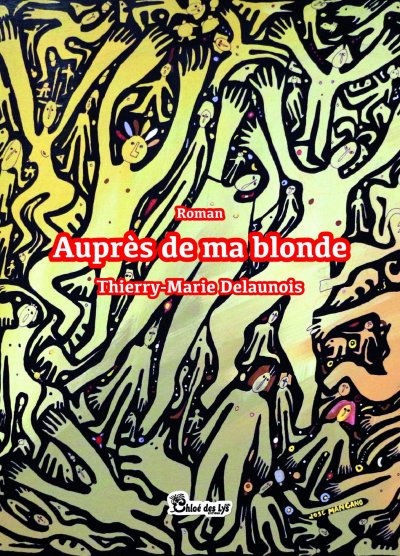
Auprès de ma blonde
de
Thierry-Marie Delaunois
Littérature
Lecture en 3½ h environ, Note : 4.8/5
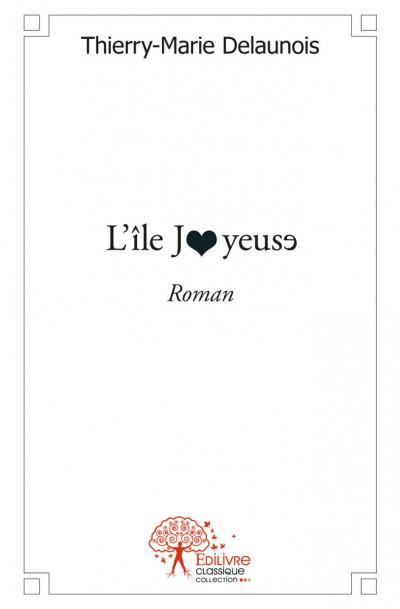
L'île Joyeuse
de
Thierry-Marie Delaunois
Littérature
Lecture en 6 h environ, Note : 4.3/5

Raconte-moi Mozart...
de
Thierry-Marie Delaunois
Littérature
Lecture en 5½ h environ, Note : 4.5/5

À ma vie, à ta mort
de
Sandra Triname
Fantastique
Lecture en 9½ h environ, Note : 4.8/5
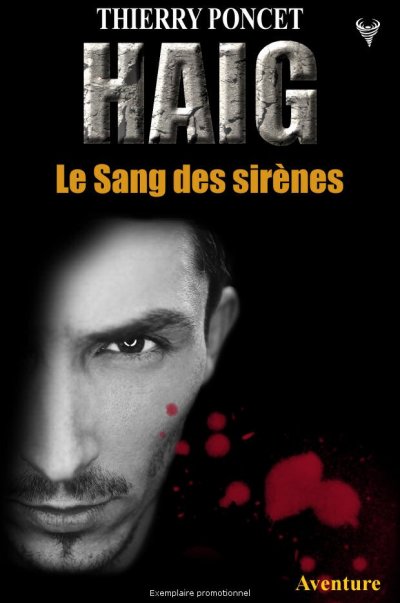
Le Sang des sirènes
de
Thierry Poncet
HAIG (3)
Aventure
Lecture en 2 h environ, Note : 4.6/5

Haïku
de
Éric Calatraba
Thriller
Lecture en 4½ h environ, Note : 4.8/5

Âmes de Verre
de
Anthelme Hauchecorne
Fantastique
Lecture en 11 h environ, Note : 4.7/5

Le Secret des Monts Rouges
de
Thierry Poncet
HAIG (1)
Aventure
Lecture en 3 h environ, Note : 4.7/5

Le reflet de la Salamandre
de
Philippe Boizart
Thriller
Lecture en 3½ h environ, Note : 4.3/5

Alvéoles
de
Eric Descamps
Techno-Thriller
Lecture en 9 h environ, Note : 4.6/5

Punk's not dead
de
Anthelme Hauchecorne
Fantastique
Lecture en 6½ h environ, Note : 4.4/5

La Guerrière de Carpics
de
Adeline Neetesonne
Fantasy
Lecture en 5 h environ, Note : 4.2/5
Les commentaires :
JeLis
2016-10-09 19:02
Anaïs Llobet à survécu au typhon Haiyan. Ce Typhon, de catégorie 5, est considéré officieusement comme le plus violent de l’histoire. La puissance et le bilan de Haiyan (appelé localement Yolanda) sont catastrophiques. Plutôt que nous raconter directement son expérience telle qu’elle l’a vécu, Anaïs Llobet a choisi d’utiliser ses souvenirs pour nourrir une oeuvre de fiction. Même si ce mode de narration induit forcément une distance et nous protège en partie en tant que lecteur, nous ressentons malgré tout que cette distance est minime. Rien ne peux cacher l’horreur des faits, principalement à Tacloban aux Philippines, coeur du désastre.
L’auteur manie avec brio ses personnages pour nous raconter ces “vautours”, ces journalistes avides des images chocs dont nous parlions, leurs vies dans ces situations ainsi que de leur point de rupture, différents pour chacun mais bien présent. Elle nous montre aussi à travers les survivants de tels drames, comment ils continuent à avancer et à quoi ils se raccrochent.
Elle a choisi de faire l’impasse sur le coté obscure du genre humain : pillage, marché noir... Mon but n’est pas de détailler les écarts entre cette oeuvre de fiction et la réalité, mais bien de parler d’un auteur qui pour les trois ans du drame nous propose un livre fort qu’elle a su nourrir avec son expérience des faits. Nous sentons qu’elle a réussit, au moins en partie, à assimiler les événements, pour nous les restituer avec courage. Les images surgissent d’elles mêmes, fortes, puissantes, sous nos yeux de lecteurs occidentaux protégés de ces cataclysmes hors normes. Nos pauvres tempêtes feraient sourire les philippins. De ce point de vu, je dirais que l’auteur remplit pleinement son objectif et il aurait été dommage qu’elle n’écrive pas ce livre.
Mon instinct de survie avais pris le pas sur mon instinct maternel. Il aura suffi d’une vague. Une vague pour effacer douze ans de maternité.
Cette distance est d’autant moins grande qu’elle a choisi pour personnage principal une journaliste, comme elle. Allié à une écriture vivante, un comble pour décrire autant de morts, et à l’aide d’images puissantes, trop pour être toutes citées ici, elle va passer rapidement sur l’attaque du typhon pour se concentrer sur les dégâts et sur les jours qui ont suivi pour la population épargnée. L’horreur de la réalité va s’accroître par la mise en perspective de la joie de son rédacteur en chef quand il apprend qu’elle est sur place et qu’il va pouvoir obtenir des scoops avant que les autres rédactions aient le temps de se déplacer. Perspective mise en relief elle-même par le besoin d’envoyer des messages et des images chocs pour nous intéresser nous, opinion public, étape elle-même indispensable pour obtenir l’aide internationale et pouvoir aider les survivants de Tacloban détruit à plus de 80%.Leurs rédactions ne voulaient pas les y envoyer avant d’avoir l’assurance que les images de la catastrophe étaient suffisamment boulversantes pour tenir la une plusieurs jours.
... nous passerons par l’Astrodome, le grand stade près de la mer dont presque personne n’est sorti vivant, promet-il, comme s’il établissait le circuit d’un bus touristique.
Irene paraît rassurée. Elle aura ses images “chocs” pour le journal télévisé du soir.
Irene paraît rassurée. Elle aura ses images “chocs” pour le journal télévisé du soir.
Le futur impact de son image l’a déjà déshumanisé : il est devenu un moyen d’intéresser les téléspectateurs à une tragédie qui se déroule trop loin de chez eux.
Je ne propose pas à Irene de supprimer ces images révoltantes. Nous avons besoin d’elles. [...] Seul le menton de l’enfant, où goutte l’eau, seules les images les plus choquantes sauront braver l’oubli.
Je ne propose pas à Irene de supprimer ces images révoltantes. Nous avons besoin d’elles. [...] Seul le menton de l’enfant, où goutte l’eau, seules les images les plus choquantes sauront braver l’oubli.
Elle a raison, après tout, me dis-je. Les gens ne retiennent rien. Faisons-les pleurer, et ils se souviendront de Yolanda.
L’auteur manie avec brio ses personnages pour nous raconter ces “vautours”, ces journalistes avides des images chocs dont nous parlions, leurs vies dans ces situations ainsi que de leur point de rupture, différents pour chacun mais bien présent. Elle nous montre aussi à travers les survivants de tels drames, comment ils continuent à avancer et à quoi ils se raccrochent.
Soudain, ce cri. Celui d’Irene. Celui d’une journaliste que je n’aurais jamais crue capable de refuser de filmer l’insoutenable. Elle s’assoit brutalement.
Elle a choisi de faire l’impasse sur le coté obscure du genre humain : pillage, marché noir... Mon but n’est pas de détailler les écarts entre cette oeuvre de fiction et la réalité, mais bien de parler d’un auteur qui pour les trois ans du drame nous propose un livre fort qu’elle a su nourrir avec son expérience des faits. Nous sentons qu’elle a réussit, au moins en partie, à assimiler les événements, pour nous les restituer avec courage. Les images surgissent d’elles mêmes, fortes, puissantes, sous nos yeux de lecteurs occidentaux protégés de ces cataclysmes hors normes. Nos pauvres tempêtes feraient sourire les philippins. De ce point de vu, je dirais que l’auteur remplit pleinement son objectif et il aurait été dommage qu’elle n’écrive pas ce livre.
Ici, les héros ne portent pas de cape rouge ni de collant bleu, mais des bidons d’eau sur des kilomètres. Ils restent à l’hôpital secourir des inconnus au lieu de courir vérifier que leur propre famille est vivante. Ils n’ont pas le pouvoir de devenir invisibles, mais ils sacrifient leur ration de riz pour un étranger. Et quand arrive le générique, [ils] quittent la scène sans applaudissements.
Dernier livre lu : Le Dernier festin des vaincus de Estelle Tharreau